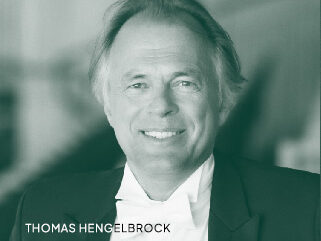Nul doute, cet été se passe sous les auspices de la compétition sportive… mais la musique a également toute sa place.
Grand Angle – Par Aude Giger
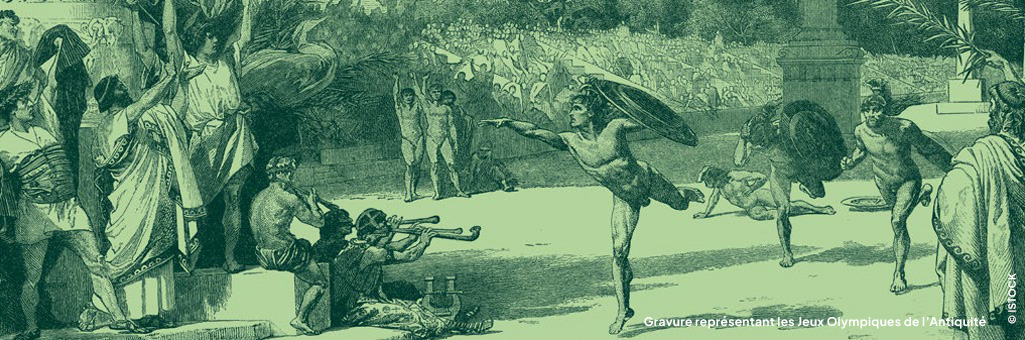
L’Orchestre de chambre de Paris se met au diapason de l’Olympiade Culturelle, déployée à l’occasion des Jeux Olympiques jusqu’au 8 septembre 2024, date de la clôture des Jeux Paralympiques. Pour cette entreprise, un objectif : mettre à l’honneur les valeurs qui la portent.
Inclusion, diversité culturelle et universalisme sont honorés dans une série de concerts ouverts sur l’actualité.


« Le sport est néfaste à notre art, en ce sens qu’il détourne les jeunes générations des salles closes où l’esprit pense, rêve, s’émeut, s’exalte sous le souffle du verbe sonore […]. Quant à être pour l’artiste une source d’inspiration, le sport n’y faillira certes point : une musique appropriée accompagnera les manifestations sportives de l’avenir ; elle sera sans doute, en sa mécanique sèche et brutale, digne de ces athlètes incomplets et se rapprochera de la nature primitive ; mais c’est assez dire aussi qu’elle sera éloignée de l’art véritable, tel que des siècles de civilisation laborieuse l’ont perfectionné, et indigne des grands artistes qui la pratiquèrent. Considéré au point de vue artistique […], le sport s’avère jusqu’à présent l’auteur de régression et destructeur d’idéal. »
Ce texte piquant et mordant du compositeur, musicologue et critique français Jean Poueigh conclut une longue enquête intitulée « La Musique et le sport » publiée par la revue hebdomadaire Le Guide du concert en 1924 alors que Paris accueille la septième édition des Jeux Olympiques modernes. Si la voix de Jean Poueigh n’est pas représentative de l’ensemble des avis exprimés, la réponse pleine d’humour de Roland-Manuel illustre pour sa part la vivacité du débat qui sévit : « Laissez-moi vous dire qu’au-dessus de quatre-vingts kilos, on peut malaisément louer le sport avec sincérité et le détester sans ridicule : la balance du pharmacien m’oblige à me récuser… »
MUTATIONS SOCIALES, CONCURRENCE ET RÉCONCILIATION
Les décennies s’écoulent et les réflexions ne perdent rien de leur acuité. Tandis que les mutations sociales apportent un éclairage neuf au débat, la question de la concurrence entre les disciplines est loin d’être résolue. En 2022, le ministre de l’Intérieur déclare que les événements culturels seront appelés à « faire des efforts » s’ils tiennent à maintenir leur présence pendant les Jeux Olympiques.
L’union entre le sport et les arts se remarque d’abord et avant tout sur la tête de certains de nos plus grands artistes. On songe bien sûr aux irremplaçables parties de tennis entre Gershwin et Schoenberg à Beverly Hills en Californie ou à celles, plus anecdotiques, entre Ravel et Debussy.
On se souvient également de la passion de Chostakovitch pour le foot qu’il nommait « le ballet des masses ». Pour le géant du piano Aldo Ciccolini, le parallèle entre art et activité physique était devenu une évidence à l’orée du XXIe siècle alors qu’il affirmait : « Le musicien d’aujourd’hui est devenu un sportif, et la musique une compétition. »
Fort de ces quelques éléments de démonstration non exhaustifs, on peut considérer avec certitude que la bienveillance à l’égard de l’activité sportive est de mise dans la sphère artistique au sens large. À l’inverse, que penser d’une manifestation sportive qui ne s’accompagnerait pas de musique ?
Les « belles sonneries pour des cortèges d’athlètes », pour reprendre l’expression de Charles Koechlin, portent souvent les moments de communion à leur plus haut degré d’élévation. Le compositeur britannique Tony Britten a ainsi rendu hommage à Zadok the Priest de Haendel en composant en 1992 l’hymne de la Ligue des champions qui bouleverse les supporters. De leurs côtés, les organisateurs des Jeux Olympiques ont su mettre à l’honneur la création musicale de leur temps, lorsqu’ils demandèrent dès 1896 (première édition des Jeux Olympiques modernes) à Spýros Samáras, élève grec de Massenet, de produire un hymne olympique. Suivront Richard Strauss en 1936 (bien que déclarant à Zweig : « Je tue l’ennui en composant un hymne olympique pour les prolétaires […] moi qui hais et méprise les sports »), Bernstein pour le Congrès olympique de 1981, John Williams à partir de 1984…
UNIS PAR DES MÊMES VALEURS
Le 5 août 1904, l’idéaliste Pierre de Coubertin prend la parole dans Le Figaro pour promouvoir un rapprochement plus intime du sport et des arts : « L’heure est venue de franchir une étape nouvelle et de restaurer l’olympiade dans sa beauté première. Au temps de la splendeur d’Olympie […], les lettres et les arts harmonieusement combinés avec le sport assuraient la grandeur des Jeux Olympiques. Il doit en être de même dans l’avenir. […] Peut-être que les artisans de la plume et du pinceau que nous aurons conviés à nous y aider nous sauront gré quelque jour d’avoir rouvert à leurs talents anxieux de renouveau des sources oubliées de noblesse et de beauté. »
De 1912 à 1948, cinq catégories artistiques1 entrent en jeu et confèrent une grandeur nouvelle aux manifestations olympiques.
À ce titre, le compositeur tchécoslovaque Josef Suk obtient une médaille d’argent à Los Angeles, pour son œuvre Towards a New Life en 1932.
Dans cet esprit, une programmation culturelle adossée aux Jeux Olympiques est déployée depuis 2021 dans toutes les zones du territoire hexagonal.Elle se tient jusqu’au 8 septembre 2024, jour de la clôture des Jeux Paralympiques. Au lancement du projet en France, l’ancienne ministre de la Culture Rima Abdul-Malak précisait ainsi, en référence à l’initiative de Pierre de Coubertin : « L’Olympiade Culturelle que nous connaissons aujourd’hui est le prolongement de cette ambition originelle d’allier le muscle à l’esprit. »
Depuis les Jeux de Barcelone en 1992, tous les pays hôtes des compétitions olympiques et paralympiques sont invités à mettre en place une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui accompagne les événements sportifs – une « occasion de mettre en relief à la fois le patrimoine sportif exceptionnel de notre pays, mais aussi l’énergie et la créativité de nos artistes », souligne Rima Abdul-Malak.
Accordé par Paris 2024, le label de l’Olympiade Culturelle sanctionne une dynamique d’exploration des liens entre l’art et le sport, mais aussi des valeurs communes à ces deux lieux de réalisation majeurs comme l’excellence, l’inclusion, la diversité culturelle, l’universalisme… La directrice culturelle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 Dominique Hervieu se confiait au micro de France Culture en janvier dernier : « Nous sentons que ce thème du sport est très fédérateur.
C’est très poreux avec toutes les questions de société : les femmes et le sport, l’environnement et le sport, les questions géopolitiques… il y a plein de façons, à travers le sport, de parler de sujets très larges. » Environ 2 000 projets ont été recensés dans ce cadre au niveau national.
L’Orchestre de chambre de Paris a saisi l’occasion pour affirmer son partage des valeurs communes au sport et à l’art et montrer son engagement social, à l’œuvre dans chacune de ses programmations, ainsi que le rappelle Brigitte Lefèvre, présidente de l’ensemble : « Nous avons la chance de nous consacrer à un art qui nous élève et […] l’orchestre le partage dans des lieux où il est moins attendu. Nous avons engagé de nombreuses actions culturelles avec des personnes en situation de précarité, d’éloignement ou d’empêchement. À chaque fois, c’est un énorme pari. »
Les musiciens et leur chef, fortement attachés à la Ville de Paris, démontrent tout naturellement leur lien avec des valeurs partagées par le sport à l’occasion des événements qui rythment la saison : programmes de transmission à l’égard de jeunes compositrices, projets participatifs avec des collégiens peu familiarisés à la musique classique… Deux projets phares, le premier à l’occasion de la Fête de la musique sur le parvis de l’Hôtel de Ville et le second au Panthéon en septembre, ainsi que quelques concerts, s’inscrivent dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, en cohérence avec la démarche de l’Orchestre de chambre de Paris.
1 L’architecture, la littérature, la musique, la peinture et la sculpture.
Nous avons la chance de nous consacrer à un art qui nous élève et […] l’orchestre le partage dans des lieux où il est moins attendu.
Brigitte Lefèvre, présidente de l’Orchestre de chambre de Paris
Le Panthéon réunit des héros sportifs qui dépassent leurs limites. Beethoven et Fauré incarnent eux aussi cette idée de dépassement.
Concert du 7 septembre 2024
Point d’orgue de cette série liée à l’Olympiade Culturelle, un concert dirigé par Thomas Hengelbrock au Panthéon le 7 septembre accompagne la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques du 8 septembre. Les œuvres de Beethoven et Fauré, deux compositeurs affectés par un problème de surdité, sont interprétées dans ce lieu emblématique de la capitale. Le dépassement des limites est tout autant celui des héros du Panthéon que celui de deux compositeurs confrontés à la surdité.
Marqué par une forte dimension expérimentale, le Quatuor à cordes n° 15 de Beethoven tient une place à part dans le corpus des seize quatuors du compositeur allemand. Largement annonciateur du romantisme, il présente une structure en cinq mouvements – innovation qui préfigure la grande forme en « arche » que l’on retrouvera dans les quatuors à cordes de Bartók. La richesse harmonique et mélodique s’accompagne d’une diversité de styles (choral, marche, récitatif instrumental…), qui ajoute à la complexité du langage. Une couleur dramatique et angoissée parcourt l’ensemble de l’oeuvre. Le troisième mouvement, donné par l’orchestre à l’occasion de ce concert, intitulé « Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart » (Chant sacré de reconnaissance d’un convalescent à la divinité, dans le mode lydien), constitue le point culminant de l’œuvre.
Beethoven vient d’affronter une grave maladie, nous sommes en 1825, et ce passage témoigne de sa gratitude et de sa grande intériorité. L’Orchestre de chambre de Paris livrera une orchestration du troisième mouvement, propice à en illustrer toute la densité de l’écriture.
Composé sur plus de dix ans dans le respect de la réforme liturgique insufflée par les papes Léon XIII et Pie X (retour au chant grégorien et sobriété), le Requiem de Fauré est néanmoins une oeuvre profane car donné dans sa mouture finale en 1900 au palais du Trocadéro. Le compositeur y a déposé tout ce qu’il avait de raffinement et d’élégance, en évoquant la mort avec une intimité bouleversante : « un requiem doux comme moi-même, un requiem dont on a dit qu’il n’exprimait pas l’effroi de la mort », de l’avis même du compositeur, agnostique, pour qui le trépas s’annonçait comme « une délivrance heureuse » et non comme un « passage douloureux ». Ainsi se clôt cette série de concerts qui vous convaincront, s’il le fallait encore, qu’on ne peut cultiver un esprit sain hors d’un corps sain ! Et dans sa grande sagesse, Ravel mérite bien le dernier mot : « Le sport peut être une source abondante d’inspiration, aussi bien que l’amour, la mort, les étoiles, la forêt, l’usine, le cirque, le métro ; s’il ne doit en découler de la pure musique. Tout le reste, en effet, n’est que littérature. »